
La servitude a la peau dure. L'épaule de John Mulbah s'est fabriqué une carapace, mais s'enfonce bizarrement en son milieu. Précisément au point d'équilibre où, trois à quatre fois par jour, pèse sur son corps le long balancier lesté de deux seaux remplis de latex. John Mulbah porte les stigmates de l'employé de la plantation d'Harbel, à une quarantaine de kilomètres au sud de Monrovia, la capitale du Liberia. Le cal du saigneur d'hévéas. Le sceau de Firestone.
"Trente-sept pounds...", "38 pour le second...". L'un après l'autre, John Mulbah et ses compagnons suspendent leurs récipients au crochet de la balance. Plus de 60 kilos sur le dos. lls versent ensuite le latex dans une cuve emplie d'ammoniaque, pour le diluer avant qu'un camion ne le ramasse. Les vapeurs les font vaciller. Les fronts transpirent à gouttes épaisses. Puis les frêles silhouettes repartent sur la piste — terrible ballet de funambules avançant à petits pas comptés et pressés, comme si chacun savait que, même lorsque les seaux sont vides, un pas de côté sur la route du rituel journalier mettrait le salaire et la survie de la famille en danger.
Trois ou quatre fois, selon leur état de forme, John Mulbah et ses amis parcourent le long kilomètre qui les mène de la plantation à la balance, sept jours sur sept. Ils font partie des 6 000 salariés libériens déclarés de Firestone, une société américaine rachetée par le japonais Bridgestone — première entreprise mondiale de pneus en valeur boursière et deuxième producteur, derrière le français Michelin. Les pauvres tongs de John Mulbah disent toute l'histoire. Il faut compter 10 dollars (8 euros) pour une paire de bottes marquées Firestone. John Mulbah en gagne à peine 3 par jour.
Tous les matins, John Mulbah, 43 ans, 8 enfants, se lève à l'aube et quitte avec ses amis sa case de la "Division 44". A 5 h 30, torche à la main, il retrouve William Togbah, le veilleur, qui, durant la nuit, dissuade avec sa petite fronde à oiseaux les voleurs qui rôdent. De haut en bas, en un long chevron, John entaille de sa machette "ses" hévéas — les "650 à 800 arbres" assignés à chacun par la direction. A cette heure matinale, le latex, liquide, blanc, brillant avant de devenir collant, ruisselle dans les coupelles arrimées au tronc, juste sous l'encoche. Accrochées par milliers aux arbres, elles ressemblent à une multitude de mains tendues attendant l'aumône — l'offrande à un pauvre petit Etat d'Afrique de l'Ouest de 3 millions d'habitants coincé entre la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire, et dévasté par quatorze ans de guerre civile.
Le travail ne s'arrête pas là. Il faut laver les coupelles et asperger les arbres au Difolatan, un produit classé dangereux qui accroît la production de résine. Il y a peu, la direction de Firestone a offert à ses employés des lunettes en plastique. Mais les yeux fatigués des OS du caoutchouc ne voient plus le haut de l'arbre derrière ces hublots. Alors, les tappers (de "tap", inciser) les oublient chez eux. Tous les après-midi, entre l'assiette de riz du repas et la tombée de la nuit, ils repartent encore, pieds nus, faucher les herbes et entretenir les hévéas.
"On nous force à travailler. Quand on se plaint, ils disent : 'Il y a 200 personnes qui attendent ta place'", raconte William Togbah. "Comment tu peux partir d'ici, dans un pays où il n'y a pas de travail ?, poursuit John Mulbah. Moi, j'ai étudié douze ans à l'école. J'ai fait des études de mécanique. Je sais quels mots il faut mettre sur les choses. C'est de l'esclavage, comme dans les livres d'histoire. On joue avec les acides et l'ammoniaque. Ce travail, on ne fait qu'en mourir."
Tout cela, l'automobiliste qui, pour gagner l'ouest du comté de Margibi, est autorisé par les gardiens à traverser la verdoyante plantation ne peut pas le deviner. Vu de la route principale — le plus beau bitume du pays —, tout coule pour le mieux. "Bienvenue chez Firestone", dit la pancarte, à l'entrée de la propriété de 400 000 hectares. Derrière des tours de bois dressées comme des miradors, 8 millions d'hévéas se tordent vers le ciel en rangées parallèles. A côté, les jeunes plants sont couvés depuis deux ans. La guerre a laissé les plantations libériennes livrées à elles-mêmes, et les exportations de caoutchouc du pays plafonnent depuis à 39 millions de dollars (32,5 millions d'euros).
Deux drapeaux flottent sur le bâtiment en briques de la direction : celui du Liberia et celui de Firestone. Les histoires, toutes deux américaines, se confondent. Inspiré par quelques philanthropes des Etats-Unis qui voulaient y "rapatrier" des esclaves affranchis, le petit Etat africain prend son indépendance en 1847. Sa capitale, Monrovia, porte le nom du cinquième président des Etats-Unis, James Monroe. Une étoile du drapeau des Etats-Unis s'est envolée sur la bannière du Liberia, et l'anglais a été naturellement choisi comme langue officielle. La plantation, elle, s'installe en 1926. Mais les géants de l'automobile avaient fait de la production de caoutchouc la première activité économique du pays dès avant la seconde guerre mondiale. Depuis, Firestone ressemble à une réserve protégée. Durant le conflit qui, entre 1989 et 2003, aurait tué 250 000 personnes, l'usine n'a jamais été touchée, contrairement aux habitations. Signée pour une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, et une bouchée de pain, la concession a été reconduite en 2005 pour dix-sept années supplémentaires, "en compensation des années perdues durant la guerre civile", se réjouit-on chez Firestone. L'embargo décrété par les Nations unies sur les exportations de diamants, en 2001, puis de bois, en 2003, parce que leur commerce finançait la guerre civile, n'a cependant jamais touché le caoutchouc.
La visite officielle n'oublie ni l'hôpital en reconstruction, ni les maisons en briques du personnel hospitalier, ni les écoles. Le tout, se garde de préciser le guide, est réservé aux ouvriers de Firestone justifiant d'un certificat de naissance. Un autobus — jaune comme les taxis new-yorkais — ramasse des petits élèves en chemise orange, jupe verte ou culottes courtes. Un arrêt dessert même un square où des pneus jouent les balançoires.
Pas d'arrêt, en revanche, devant les divisions numérotées des ouvriers des plantations. Les murs sont en terre, rarement en dur. Les toits en tôle ondulée. La famille — souvent plus de 10 personnes — se partage une pièce, parfois deux. Pas d'eau courante : il faut aller tirer celle de la rivière à la pompe la plus proche. A un bout du camp, des latrines à la turque et, derrière une palissade en feuilles de palmiers, la douche du camp. Pas d'électricité non plus : à 7 heures du soir, les pièces sont plongées dans le noir, quand s'allument, là-haut, les maisons des dirigeants de la plantation, du côté du golf, "où viennent jouer des ministres, des personnes des ambassades, des Nations unies, de l'Union européenne", raconte Salomon, le gardien du green.
On partage les lits, mais aussi le riz, vendu par Firestone et prélevé sur le salaire, 25 dollars pour les 2 sacs de 50 kg. Les gamelles sont souvent plus nombreuses que le cercle strictement familial. Parmi le million de personnes déplacées durant la guerre, beaucoup ont en effet trouvé refuge dans la plantation. "Avec les arbres et les heures supplémentaires, l'aide de ma femme et celle d'un ami, explique le tapper Joseph Kerkula, 5 enfants, j'arrive à 140 dollars par mois. Je reverse ensuite 30 dollars et 25 kg de riz à mon ami."
Dix mille personnes travailleraient ainsi indirectement pour Firestone, selon Robert Nyahn, grandi dans la "Division 6" de la plantation. Parmi elles figurent des enfants, assure sa petite ONG libérienne, Save My Future Foundation (Samfu), dans un rapport publié en novembre 2005 sur Internet et consacré au travail dans cette plantation.
Depuis, la direction de Firestone, agacée, a affiché sur ses murs un avis qui interdit le travail des enfants. "Nous sommes beaucoup plus attentifs à ce problème depuis un an. Il entache notre image de marque. Le problème, c'est que, à 12 ans, beaucoup veulent travailler avec leurs parents, assure le Libérien Edwin Padmore, responsable des relations publiques de Firestone dans le pays. Quant aux personnes déplacées, nous faisons preuve d'une grande tolérance. Nous ne pouvons pas les mettre dehors. Le problème, c'est qu'au lieu d'avoir 10 personnes à la maison, ils sont 20 à partager le riz."
En suivant M. Padmore, on ne s'arrête pas non plus dans l'usine où est conditionné le caoutchouc destiné à l'exportation, au bord de la rivière Farmington. "Nous sommes satisfaits du niveau de pollution", dit seulement le porte-parole. Les déchets sont pourtant rejetés directement dans le cours d'eau. Derrière l'usine, à la sortie de la bouche d'évacuation, de jeunes hommes se pressent en pirogue pour lancer des filets. La pêche, en effet, y est miraculeuse. Les poissons perdent de la vitesse, ne filent pas à travers les mailles. "Ils sont saouls", expliquent deux pêcheurs.
Sur l'autre rive, en aval, à Owensgrove City, les témoignages concordent. Johnson Yahanly, 75 ans, 38 dollars de retraite par mois, a travaillé trente ans comme plombier dans l'usine où est traité le caoutchouc. "Ils m'ont rendu aveugle", assure-t-il, les yeux mi-clos, appuyé sur son bâton. La peau de Johnny Clinton, ancien pêcheur de 60 ans, porte comme un dépôt de lichen vert. "Tout le temps je sentais cette mauvaise odeur. Le courant faisait affluer et refluer des nappes blanches", raconte une autre femme, qui a quitté la rive.
Hawa Nagbe, elle, se souvient qu'elle passait des heures accroupie dans la rivière Farmington, à vendre des casiers en osier pour les pêcheurs. Aujourd'hui, ses pieds sont comme couverts de mazout noir jusqu'aux genoux.
"Beaucoup de personnes qui habitaient juste en face de l'usine sont parties, explique David Bweeh, le préfet du district de Grand-Bassa tout proche. On essaie d'expliquer aux femmes de ne plus laver le linge dans la rivière." "Outre les conséquences des chutes, nombreuses, et des éclaboussures d'ammoniaque, nous constatons beaucoup d'affections gastriques", convient lui-même le médecin-chef de l'hôpital Firestone, le docteur Lyndon Mabande, en ajoutant : "Lorsqu'ils travaillent dans le bush, ils boivent une eau contaminée."
En décembre 2005, la petite Samfu, épaulée par une autre ONG américaine, le Fonds international pour les droits des travailleurs (ILRF), a porté plainte contre Firestone devant la Cour fédérale de Californie, aux Etats-Unis, pour "travail forcé, l'équivalent moderne de l'esclavage", pratiqué sur la plantation d'Harbel. L'assignation, déposée au nom de 12 ouvriers libériens et de leurs 23 enfants, cite une étude de 1956 parlant d'un "quota journalier de 250 à 300 arbres" et, "en 1979, de 400 à 500 arbres" — contre 800, semble-t-il, aujourd'hui.
"Tissu d'inepties, balaie M. Padmore. 'Esclavage', ce mot sonne pour nous comme une offense. Le Liberia a été à l'origine une terre de refuge pour des citoyens libres. C'est notre histoire. Nous ne pouvons pas en faire un pays d'esclaves. Le salaire moyen est de 3,38 dollars pour huit heures par jour, soit largement plus que la moyenne nationale, dans un pays qui compte 80 % de chômeurs. Le quota est de 650 arbres au maximum. Le travail le dimanche est en option, et les heures supplémentaires payées double." Puis, agacé : "Le problème, c'est que depuis cent ans, en Malaisie, au Vietnam, on n'a pas trouvé d'autre moyen de produire du caoutchouc que de saigner les arbres et de porter le latex dans des seaux."
Toute la production de Firestone — un chiffre gardé secret, file du port de Monrovia jusqu'aux Etats-Unis, sur le cargo The-Prince-of-Tapper. Au Liberia, on ne transforme pas les millions de tonnes de caoutchouc ou de latex en produits finis. Pas d'emplois, pas de ventes. Ou si peu. Ce matin, au marché de Caldwell Junction, à la sortie de la capitale, un mystérieux camion blanc se gare le long des étals. De jeunes garçons en sortent pour débarquer la marchandise. Ils viennent de Conakry, quatre jours de route pour décharger leur trésor et tenter de le vendre à Monrovia.
Leur trésor ? Des colliers de pneus... venus de Bruxelles via la Guinée. Des Dunlop, des Michelin, des Bridgestone, qu'ils entassent dans les brouettes. Des pneus usés, ceux dont les Européens ne veulent plus, vendus "6 à 7 dollars" aux Africains de Monrovia.
Ariane Chemin"Trente-sept pounds...", "38 pour le second...". L'un après l'autre, John Mulbah et ses compagnons suspendent leurs récipients au crochet de la balance. Plus de 60 kilos sur le dos. lls versent ensuite le latex dans une cuve emplie d'ammoniaque, pour le diluer avant qu'un camion ne le ramasse. Les vapeurs les font vaciller. Les fronts transpirent à gouttes épaisses. Puis les frêles silhouettes repartent sur la piste — terrible ballet de funambules avançant à petits pas comptés et pressés, comme si chacun savait que, même lorsque les seaux sont vides, un pas de côté sur la route du rituel journalier mettrait le salaire et la survie de la famille en danger.
Trois ou quatre fois, selon leur état de forme, John Mulbah et ses amis parcourent le long kilomètre qui les mène de la plantation à la balance, sept jours sur sept. Ils font partie des 6 000 salariés libériens déclarés de Firestone, une société américaine rachetée par le japonais Bridgestone — première entreprise mondiale de pneus en valeur boursière et deuxième producteur, derrière le français Michelin. Les pauvres tongs de John Mulbah disent toute l'histoire. Il faut compter 10 dollars (8 euros) pour une paire de bottes marquées Firestone. John Mulbah en gagne à peine 3 par jour.
Tous les matins, John Mulbah, 43 ans, 8 enfants, se lève à l'aube et quitte avec ses amis sa case de la "Division 44". A 5 h 30, torche à la main, il retrouve William Togbah, le veilleur, qui, durant la nuit, dissuade avec sa petite fronde à oiseaux les voleurs qui rôdent. De haut en bas, en un long chevron, John entaille de sa machette "ses" hévéas — les "650 à 800 arbres" assignés à chacun par la direction. A cette heure matinale, le latex, liquide, blanc, brillant avant de devenir collant, ruisselle dans les coupelles arrimées au tronc, juste sous l'encoche. Accrochées par milliers aux arbres, elles ressemblent à une multitude de mains tendues attendant l'aumône — l'offrande à un pauvre petit Etat d'Afrique de l'Ouest de 3 millions d'habitants coincé entre la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire, et dévasté par quatorze ans de guerre civile.
Le travail ne s'arrête pas là. Il faut laver les coupelles et asperger les arbres au Difolatan, un produit classé dangereux qui accroît la production de résine. Il y a peu, la direction de Firestone a offert à ses employés des lunettes en plastique. Mais les yeux fatigués des OS du caoutchouc ne voient plus le haut de l'arbre derrière ces hublots. Alors, les tappers (de "tap", inciser) les oublient chez eux. Tous les après-midi, entre l'assiette de riz du repas et la tombée de la nuit, ils repartent encore, pieds nus, faucher les herbes et entretenir les hévéas.
"On nous force à travailler. Quand on se plaint, ils disent : 'Il y a 200 personnes qui attendent ta place'", raconte William Togbah. "Comment tu peux partir d'ici, dans un pays où il n'y a pas de travail ?, poursuit John Mulbah. Moi, j'ai étudié douze ans à l'école. J'ai fait des études de mécanique. Je sais quels mots il faut mettre sur les choses. C'est de l'esclavage, comme dans les livres d'histoire. On joue avec les acides et l'ammoniaque. Ce travail, on ne fait qu'en mourir."
Tout cela, l'automobiliste qui, pour gagner l'ouest du comté de Margibi, est autorisé par les gardiens à traverser la verdoyante plantation ne peut pas le deviner. Vu de la route principale — le plus beau bitume du pays —, tout coule pour le mieux. "Bienvenue chez Firestone", dit la pancarte, à l'entrée de la propriété de 400 000 hectares. Derrière des tours de bois dressées comme des miradors, 8 millions d'hévéas se tordent vers le ciel en rangées parallèles. A côté, les jeunes plants sont couvés depuis deux ans. La guerre a laissé les plantations libériennes livrées à elles-mêmes, et les exportations de caoutchouc du pays plafonnent depuis à 39 millions de dollars (32,5 millions d'euros).

Deux drapeaux flottent sur le bâtiment en briques de la direction : celui du Liberia et celui de Firestone. Les histoires, toutes deux américaines, se confondent. Inspiré par quelques philanthropes des Etats-Unis qui voulaient y "rapatrier" des esclaves affranchis, le petit Etat africain prend son indépendance en 1847. Sa capitale, Monrovia, porte le nom du cinquième président des Etats-Unis, James Monroe. Une étoile du drapeau des Etats-Unis s'est envolée sur la bannière du Liberia, et l'anglais a été naturellement choisi comme langue officielle. La plantation, elle, s'installe en 1926. Mais les géants de l'automobile avaient fait de la production de caoutchouc la première activité économique du pays dès avant la seconde guerre mondiale. Depuis, Firestone ressemble à une réserve protégée. Durant le conflit qui, entre 1989 et 2003, aurait tué 250 000 personnes, l'usine n'a jamais été touchée, contrairement aux habitations. Signée pour une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, et une bouchée de pain, la concession a été reconduite en 2005 pour dix-sept années supplémentaires, "en compensation des années perdues durant la guerre civile", se réjouit-on chez Firestone. L'embargo décrété par les Nations unies sur les exportations de diamants, en 2001, puis de bois, en 2003, parce que leur commerce finançait la guerre civile, n'a cependant jamais touché le caoutchouc.
La visite officielle n'oublie ni l'hôpital en reconstruction, ni les maisons en briques du personnel hospitalier, ni les écoles. Le tout, se garde de préciser le guide, est réservé aux ouvriers de Firestone justifiant d'un certificat de naissance. Un autobus — jaune comme les taxis new-yorkais — ramasse des petits élèves en chemise orange, jupe verte ou culottes courtes. Un arrêt dessert même un square où des pneus jouent les balançoires.
Pas d'arrêt, en revanche, devant les divisions numérotées des ouvriers des plantations. Les murs sont en terre, rarement en dur. Les toits en tôle ondulée. La famille — souvent plus de 10 personnes — se partage une pièce, parfois deux. Pas d'eau courante : il faut aller tirer celle de la rivière à la pompe la plus proche. A un bout du camp, des latrines à la turque et, derrière une palissade en feuilles de palmiers, la douche du camp. Pas d'électricité non plus : à 7 heures du soir, les pièces sont plongées dans le noir, quand s'allument, là-haut, les maisons des dirigeants de la plantation, du côté du golf, "où viennent jouer des ministres, des personnes des ambassades, des Nations unies, de l'Union européenne", raconte Salomon, le gardien du green.
On partage les lits, mais aussi le riz, vendu par Firestone et prélevé sur le salaire, 25 dollars pour les 2 sacs de 50 kg. Les gamelles sont souvent plus nombreuses que le cercle strictement familial. Parmi le million de personnes déplacées durant la guerre, beaucoup ont en effet trouvé refuge dans la plantation. "Avec les arbres et les heures supplémentaires, l'aide de ma femme et celle d'un ami, explique le tapper Joseph Kerkula, 5 enfants, j'arrive à 140 dollars par mois. Je reverse ensuite 30 dollars et 25 kg de riz à mon ami."
Dix mille personnes travailleraient ainsi indirectement pour Firestone, selon Robert Nyahn, grandi dans la "Division 6" de la plantation. Parmi elles figurent des enfants, assure sa petite ONG libérienne, Save My Future Foundation (Samfu), dans un rapport publié en novembre 2005 sur Internet et consacré au travail dans cette plantation.
Depuis, la direction de Firestone, agacée, a affiché sur ses murs un avis qui interdit le travail des enfants. "Nous sommes beaucoup plus attentifs à ce problème depuis un an. Il entache notre image de marque. Le problème, c'est que, à 12 ans, beaucoup veulent travailler avec leurs parents, assure le Libérien Edwin Padmore, responsable des relations publiques de Firestone dans le pays. Quant aux personnes déplacées, nous faisons preuve d'une grande tolérance. Nous ne pouvons pas les mettre dehors. Le problème, c'est qu'au lieu d'avoir 10 personnes à la maison, ils sont 20 à partager le riz."
En suivant M. Padmore, on ne s'arrête pas non plus dans l'usine où est conditionné le caoutchouc destiné à l'exportation, au bord de la rivière Farmington. "Nous sommes satisfaits du niveau de pollution", dit seulement le porte-parole. Les déchets sont pourtant rejetés directement dans le cours d'eau. Derrière l'usine, à la sortie de la bouche d'évacuation, de jeunes hommes se pressent en pirogue pour lancer des filets. La pêche, en effet, y est miraculeuse. Les poissons perdent de la vitesse, ne filent pas à travers les mailles. "Ils sont saouls", expliquent deux pêcheurs.
Sur l'autre rive, en aval, à Owensgrove City, les témoignages concordent. Johnson Yahanly, 75 ans, 38 dollars de retraite par mois, a travaillé trente ans comme plombier dans l'usine où est traité le caoutchouc. "Ils m'ont rendu aveugle", assure-t-il, les yeux mi-clos, appuyé sur son bâton. La peau de Johnny Clinton, ancien pêcheur de 60 ans, porte comme un dépôt de lichen vert. "Tout le temps je sentais cette mauvaise odeur. Le courant faisait affluer et refluer des nappes blanches", raconte une autre femme, qui a quitté la rive.
Hawa Nagbe, elle, se souvient qu'elle passait des heures accroupie dans la rivière Farmington, à vendre des casiers en osier pour les pêcheurs. Aujourd'hui, ses pieds sont comme couverts de mazout noir jusqu'aux genoux.
"Beaucoup de personnes qui habitaient juste en face de l'usine sont parties, explique David Bweeh, le préfet du district de Grand-Bassa tout proche. On essaie d'expliquer aux femmes de ne plus laver le linge dans la rivière." "Outre les conséquences des chutes, nombreuses, et des éclaboussures d'ammoniaque, nous constatons beaucoup d'affections gastriques", convient lui-même le médecin-chef de l'hôpital Firestone, le docteur Lyndon Mabande, en ajoutant : "Lorsqu'ils travaillent dans le bush, ils boivent une eau contaminée."
En décembre 2005, la petite Samfu, épaulée par une autre ONG américaine, le Fonds international pour les droits des travailleurs (ILRF), a porté plainte contre Firestone devant la Cour fédérale de Californie, aux Etats-Unis, pour "travail forcé, l'équivalent moderne de l'esclavage", pratiqué sur la plantation d'Harbel. L'assignation, déposée au nom de 12 ouvriers libériens et de leurs 23 enfants, cite une étude de 1956 parlant d'un "quota journalier de 250 à 300 arbres" et, "en 1979, de 400 à 500 arbres" — contre 800, semble-t-il, aujourd'hui.
"Tissu d'inepties, balaie M. Padmore. 'Esclavage', ce mot sonne pour nous comme une offense. Le Liberia a été à l'origine une terre de refuge pour des citoyens libres. C'est notre histoire. Nous ne pouvons pas en faire un pays d'esclaves. Le salaire moyen est de 3,38 dollars pour huit heures par jour, soit largement plus que la moyenne nationale, dans un pays qui compte 80 % de chômeurs. Le quota est de 650 arbres au maximum. Le travail le dimanche est en option, et les heures supplémentaires payées double." Puis, agacé : "Le problème, c'est que depuis cent ans, en Malaisie, au Vietnam, on n'a pas trouvé d'autre moyen de produire du caoutchouc que de saigner les arbres et de porter le latex dans des seaux."
Toute la production de Firestone — un chiffre gardé secret, file du port de Monrovia jusqu'aux Etats-Unis, sur le cargo The-Prince-of-Tapper. Au Liberia, on ne transforme pas les millions de tonnes de caoutchouc ou de latex en produits finis. Pas d'emplois, pas de ventes. Ou si peu. Ce matin, au marché de Caldwell Junction, à la sortie de la capitale, un mystérieux camion blanc se gare le long des étals. De jeunes garçons en sortent pour débarquer la marchandise. Ils viennent de Conakry, quatre jours de route pour décharger leur trésor et tenter de le vendre à Monrovia.
Leur trésor ? Des colliers de pneus... venus de Bruxelles via la Guinée. Des Dunlop, des Michelin, des Bridgestone, qu'ils entassent dans les brouettes. Des pneus usés, ceux dont les Européens ne veulent plus, vendus "6 à 7 dollars" aux Africains de Monrovia.
Le Monde
Article paru dans l'édition du 03.02.06
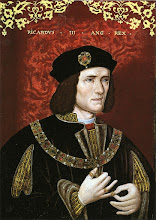
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire